On ne peut guère douter du fait que l’état du monde contemporain, marqué par une crise écologique systémique, une fragmentation sociale croissante et une instabilité économique structurelle, nécessite une révision profonde des principes sur lesquels reposent nos formes d’organisation collective. Il serait illusoire de penser que l’espèce humaine se serait affranchie de ses ancrages biocognitifs dans sa marche vers la modernité technique et institutionnelle. Les dynamiques affectives fondamentales, telles que l’appétition et l’aversion, structurent encore en profondeur les comportements individuels et collectifs. Ces forces, loin d’être de simples vestiges archaïques, opèrent comme des invariants fonctionnels dans l’ensemble des configurations sociales, y compris les plus technicisées. Toute la question est de savoir s’il est possible d’infléchir le telos autodestructeur dans lequel l’humanité s’est engagée, en replaçant ces ressorts biocognitifs au centre des transformations systémiques.
Le mythe d’Érysichthon de Thessalie, relaté par Ovide dans les Métamorphoses, offre une allégorie saisissante de la dynamique autodestructrice de l’appétition illimitée. Érysichthon, roi de Thessalie, profane un bois sacré consacré à la déesse Déméter en ordonnant l’abattage d’un chêne monumental, indifférent aux supplications des fidèles et aveugle au caractère sacré du lieu. Ce geste de transgression ne relève pas d’une nécessité mais d’un excès, d’une hybris: en rompant les limites sacrées qui protègent l’ordre du vivant, Érysichthon incarne une forme d’arrogance insensible aux équilibres symboliques et écologiques. Déméter, déesse des moissons et de la fertilité, décide de le punir non pas par un châtiment physique immédiat, mais en le livrant à une malédiction qui incarne l’inverse exact de ce qu’elle représente : une faim insatiable. Ne pouvant incarner elle-même cette force de destruction, contraire à sa fonction nourricière, elle envoie une nymphe invoquer la Faim — puissance archaïque personnifiée dans la mythologie — et l’implore de pénétrer le corps du profanateur. Dès lors, Érysichthon est possédé de l’intérieur par un besoin irrépressible de consommer. Plus il mange, plus sa faim augmente. Ce désir sans borne, devenu moteur de destruction, épuise ses ressources, ruine ses liens sociaux, le pousse jusqu’à vendre sa propre fille… avant de le conduire à se dévorer lui-même. Ovide en décrit les effets dans une série de vers d’une intensité remarquable :
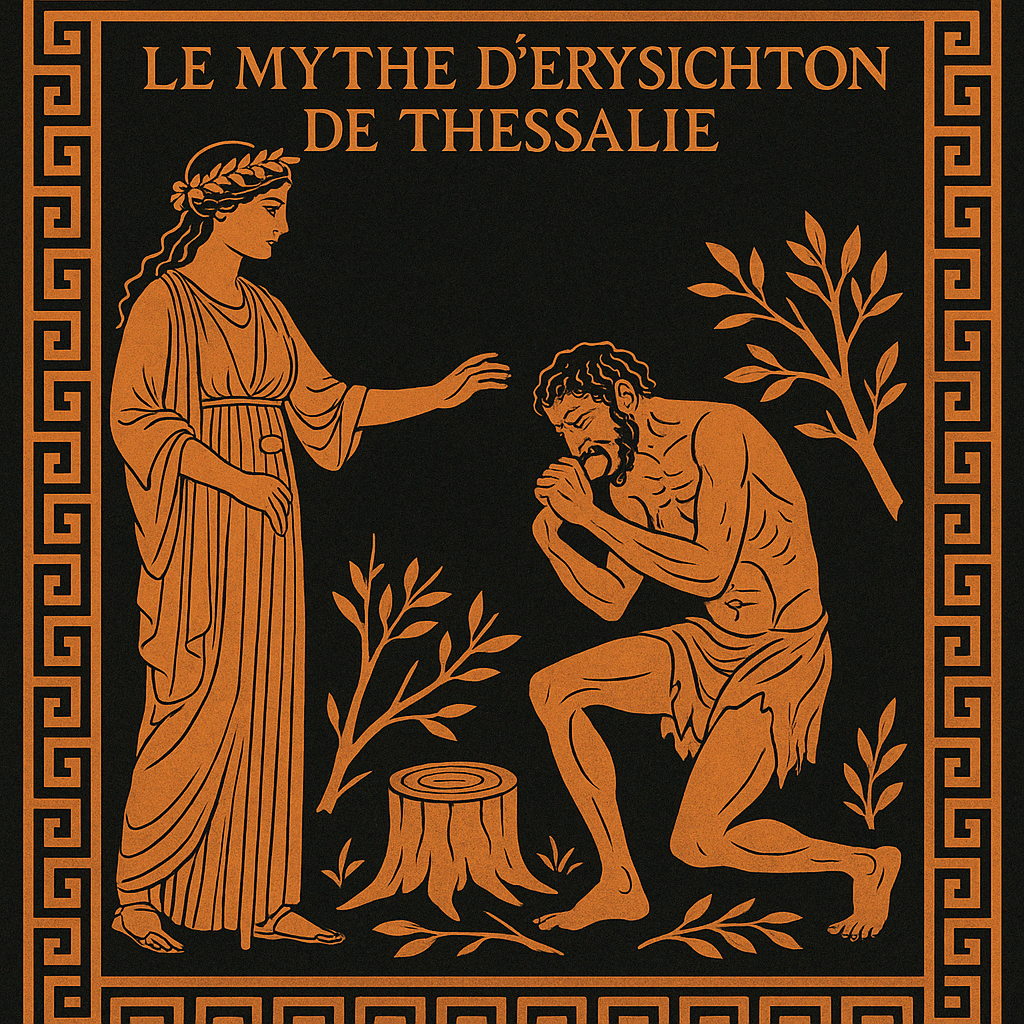
Le doux Sommeil encor de son aile paisible
Berçait Érysichthon. Il rêve de festins,
Mâche le vide, épuise, entre-heurtées, ses dents,
Tourmente son gosier de mets imaginaires, [...]
Plus sa panse engloutit, plus il veut la remplir. [...]
Manger lui donne envie
De remanger, et dévorer lui laisse un creux.
Se déchirant lui-même à coups de dents les membres,
L’infortuné nourrit son corps en l’amputant. (Ovide, 2019) - Livre VIII, v. 821–878.
La structure narrative du mythe offre ici une métaphore puissante de l’appétition débridée, vidée de toute régulation symbolique ou collective. L’ingestion devient autophagie, le désir devient destruction, et le corps même du transgresseur devient le dernier réservoir de sa propre perte. Cette séquence, n’est pas une simple fable morale, elle entre en résonance profonde avec la logique systémique d’un capitalisme contemporain qui nie ses limites et en vient à consommer jusqu’à ses propres fondements.
Les formes de vie les plus anciennes, telles que les bactéries, illustrent déjà des mécanismes d’organisation collective, à la fois adaptatifs et structurellement efficaces. Par des processus de détection du quorum, de sécrétion de substances protectrices ou d’évitement des individus non coopératifs, ces organismes unicellulaires déploient des stratégies sociales primitives d’une grande efficacité. Antonio Damasio décrit ce processus dans les termes suivants :
Les bactéries peuvent percevoir les effectifs de leur propre groupe et évaluer sa force de manière non réfléchie ; et elles peuvent, en fonction de cette force perçue, se lancer ou non dans un conflit pour défendre leur territoire. (Damasio, 2017)
Il ne s’agit pas de simples automatismes biologiques, ces dynamiques témoignent d’une logique préfigurative de la sociabilité humaine. Elles posent les fondements non conscients d’une gouvernance adaptative qui, dans le cas de l’espèce humaine, s’est par la suite complexifiée par l’intermédiaire du langage, de la conscience réflexive et des systèmes normatifs. Pour illustrer la pertinence de ce modèle biologique pour les systèmes économiques, on pourrait citer l’exemple des coopératives agricoles de la région de Mondragón en Espagne. Ces structures, inspirées par des principes de mutualisation et d’autorégulation, ont démontré une résilience supérieure lors des crises financières de 2008, en maintenant un taux de chômage inférieur à 2 % contre 25 % au niveau national (Cheney , et al., 2023). Comme les bactéries, ces coopératives ajustent leurs stratégies en fonction des signaux collectifs (chutes de demande, tensions sociales), évitant ainsi la surproduction et l’épuisement des ressources, et illustrant une gouvernance adaptative ancrée dans une coopération adaptée en fonction de la concurrence.
Les conduites humaines sont organisées autour d’une dynamique affective duale. L’appétition constitue la force d’expansion, de conquête, de désir de reconnaissance ou de possession, tandis que l’aversion se manifeste comme un mécanisme de repli, de prudence, de peur face à la perte ou à l’altérité. Ces deux forces coexistent dans un équilibre précaire, modulé par le contexte, et se cristallisent dans des formes d’éthopraxie[1], processus de structuration comportementale collective articulant dispositions profondes et contraintes de l’action située. Cette architecture affective ne disparaît pas avec la modernité : elle se réorganise sous des formes nouvelles, notamment économiques.
Cette permanence affective de la structuration de l’action humaine se manifeste aussi bien dans les comportements réflexes que dans les engagements rationnels les plus élaborés. Que l’on se situe dans la sphère génique, correspondant au système 1 des modèles dualistes de la cognition — intuitif, rapide, non réflexif — ou dans la sphère noétique, associée au système 2 — délibératif, discursif, orienté par des structures symboliques et des principes de justification — la conation[2] demeure irréductiblement affecto-dirigée (Kleden, 2022). Dans le registre génique, l’action est orientée par des signaux de valence immédiate, qu’ils soient de nature somatique, émotionnelle ou mimétique. Dans la sphère noétique (la pensée rationnelle), bien que l’activité réflexive s’élabore à travers des schèmes cognitifs complexes, elle est néanmoins structurée par des valeurs et mémotions[3] qui associent de manière consubstantielle des principes porteurs de sens et des charges affectives. Ces valeurs-mémotions, au croisement du symbolique et du pulsionnel, génèrent des affects appétitifs ou aversifs qui agissent comme catalyseurs conatifs, provoquant l’orientation des actes selon une visée téléonomique (Monod). Ainsi, même dans les sphères de la rationalité, la délibération est polarisée par des attractions et répulsions affectives, rendant toute élaboration de telos indissociable d’un substrat émotionnel. Cette continuité du pilotage affectif, depuis les impulsions géniques jusqu’aux constructions idéelles, confirme que les comportements humains, dans leur diversité, relèvent d’une dynamique unifiée d’orientation, enracinée dans les mécanismes élémentaires de valence affective.
Le capitalisme contemporain repose sur l’activation permanente de l’appétition. L’innovation, la compétition, l’optimisation, le profit, sont autant de figures de cette pulsion expansive. Dans ce modèle, l’aversion n’est pas négligée : elle est exploitée sous forme de peur – du déclassement, de l’échec, de la perte de compétitivité. Cette suractivation simultanée de l’appétition et de l’aversion produit une instabilité structurelle, génératrice de souffrance sociale et de fragmentation. Le système ne contredit pas la nature humaine : il l’instrumentalise, en déréglant ses modalités d’équilibrage spontané.
Ce dysfonctionnement semble trouver sa source dans l’autonomisation de la construction sociale vis-à-vis du socle biologique. Une grande partie de la pensée sociologique moderne, dans sa volonté d’émancipation vis-à-vis du naturalisme, a évacué les déterminations biologiques, affectives et évolutives du comportement humain. Or cette exclusion nourrit l’illusion d’une plasticité infinie des systèmes sociaux, capables de se reconfigurer uniquement par la norme ou la volonté politique. Ce déni des limites structurelles du vivant empêche de percevoir que certains processus affecto-comportementaux, comme l’aversion résultant de l’excès d’appétition, échappent à la réflexivité sociale.
Ainsi se met en place une boucle dopaminique, dans laquelle la gratification obtenue par la poursuite de l’appétition masque les effets d’aversion qu’elle génère. Ce renforcement affectif agit comme une addiction collective, neutralisant les signaux d’alerte internes et les limites environnementales. Des études en neurosciences sociales confirment ce mécanisme. Par exemple, une recherche de Knutson et al. (2007) montre que l’anticipation d’un gain monétaire active les circuits dopaminergiques du nucleus accumbens, similaire à l’excitation provoquée par des substances addictives. Ce phénomène se matérialise dans les pratiques de trading algorithmique, où les traders, stimulés par des gains instantanés, ignorent les risques systémiques (comme lors du Flash Crash de 2010). Les plateformes comme Robinhood exploitent cette dynamique via des notifications « gamifiées » (badges, confettis virtuels), transformant l’investissement en quête compulsive, au mépris des indicateurs de durabilité. Cette logique trouve un écho dans les travaux de Natasha Schüll sur les machines à sous Addiction by Design (Schüll, 2012), qui révèlent la façon dont l’appât d’un gain aléatoire et immédiat peut enfermer les individus dans un cycle d’asservissement pulsionnel : à l’instar des joueurs captifs des casinos, les utilisateurs de ces plateformes sont aliénés par une mécanique de récompenses intermittentes, où l’espoir d’un profit éphémère efface toute rationalité à long terme.
L’économie performative devient ainsi un pharmakon au sens platonicien : à la fois remède et poison. Elle stimule artificiellement la vitalité tout en détruisant les conditions de sa propre reproduction. C’est bien en ce sens que le capitalisme contemporain s’inscrit dans une logique érysichthonienne : il dévore sans fin ses ressources, ses institutions, et jusqu’à ses propres fondements. À l’image d’Érysichthon, qui consomme tout ce qui l’entoure avant de se dévorer lui-même, le capitalisme technicisé s’adonne à une appétition illimitée, vidée de tout principe régulateur. L’abattage du chêne sacré par Érysichthon — acte de transgression et de profanation écologique — trouve son équivalent contemporain dans la destruction des écosystèmes vitaux sous l’effet de logiques extractives court-termistes. La déforestation, motivée par l’expansion agricole et l’exploitation minière, détruit chaque année des millions d’hectares de forêts tropicales. Ces écosystèmes, essentiels à la régulation du climat et à la préservation de la biodiversité, sont irremplaçables : leur disparition compromet non seulement les équilibres planétaires, mais aussi les activités économiques qui en dépendent.
Les systèmes vivants les plus résilients ne sont pas ceux qui maximisent leur efficacité à court terme, mais ceux qui intègrent la redondance, la variabilité et la coopération sous contrainte. Les recherches en biologie des systèmes montrent que la robustesse repose sur la capacité à absorber les perturbations, non à les éliminer. Cette propriété adaptative, observable dans la nature, est délaissée dans l’organisation économique contemporaine. Pourtant, des modèles hybrides, comme certaines économies sociales ou coopératives, démontrent qu’il est possible de conjuguer efficacité locale et solidarité structurelle, en s’appuyant sur les principes de la diversité fonctionnelle et de la régulation contextuelle.
L’illusion selon laquelle le progrès scientifique et technologique permettrait à lui seul de surmonter les crises actuelles repose sur une incompréhension des dynamiques à l’œuvre. Tant que ce progrès reste subordonné à la logique de l’appétition illimitée, il ne fait qu’accélérer l’entropie du système. L’agriculture intensive en est une illustration criante. Les OGM et les pesticides ont boosté les rendements à court terme, mais ont appauvri une grande partie des sols européens, réduisant leur capacité à stocker du carbone (Morin, et al., 2021). Pire, l’usage massif d’engrais azotés a créé des zones mortes dans l’océan, où la vie marine est asphyxiée. Ces exemples montrent que, sans une révision des finalités et une intégration dans un cadre de durabilité globale, l’innovation technique peut reproduire les schémas autodestructeurs qu’elle prétend résoudre. Johan Rockström l’exprime avec une clarté sans détour dans Big World, Small Planet :
« Le fait est que chaque technologie de rupture, dans l’histoire de l’industrie moderne, a entraîné des effets de rebond qui, malgré des améliorations d’efficacité à court terme, ont eu des répercussions négatives sur la planète. […] Les technologies exponentielles doivent impérativement opérer à l’intérieur de limites absolues. L’abondance ne peut se concevoir que dans l’espace de sécurité défini par les frontières planétaires. (Rockström, 2015 pp. 139-140)
Les innovations techniques, aussi puissantes soient-elles, ne redéfinissent pas les finalités du système qui les produit. En demeurant enchâssées dans le paradigme performatif, elles en reproduisent les impasses. L’issue n’est pas une réingénierie des moyens, mais une inflexion des finalités collectives.
Ce déplacement peut s’opérer à partir d’une conception de l’action humaine fondée sur les équilibres fluctuants entre des forces affectives opposées. En modélisant ces dynamiques, il devient possible d’identifier les points de rupture, les zones de stabilité, ainsi que les trajectoires systémiques susceptibles d’être infléchies par une action politique ou institutionnelle. Cette approche permet d’articuler les constantes biologiques de l’espèce et les structures sociales qui les modulent. L’encastrement économique ne saurait être une injonction morale : il est une exigence fonctionnelle d’équilibre, fondée sur la reconnaissance des limites et sur la revalorisation de l’homéostasie sociale.
Le capitalisme, tel qu’il se présente aujourd’hui, n’est pas un accident d’évolution, mais une expression déformée d’une logique adaptative ancienne. En surexploitant certaines dimensions de notre fonctionnement biocognitif — telles que l’appétition immédiate, la gratification individualisée ou la compétition statutaire — tout en rendant inopérantes d’autres facultés pourtant structurantes — comme l’aversion protectrice, la mémoire intergénérationnelle ou la disposition à la coopération —, il compromet la stabilité des systèmes qu’il organise. Infléchir ce processus ne suppose pas de nier notre nature, mais de la réarticuler dans un projet collectif qui valorise la robustesse (Hamant, 2025), la coopération et la pluralité normative. Une telle transformation exige de dépasser le fantasme d’autonomie rationnelle pour assumer l’épaisseur affective, cognitive et écologique de notre condition humaine. Elle implique un réapprentissage du sens des limites, une conversion des modèles de désir collectif et une inscription durable dans les évidences oubliées du vivant.
Alan Kleden
Bibliographie
Cheney , George, et al. 2023. Cooperatives at Work. Bingley : Emerald Publishing Limited, 2023. 978-1-83867-828-9.
Damasio, Antonio. 2017. L’Ordre étrange des choses. Paris : Odile Jacob, 2017. 978-2-7381-3609-1.
Hamant, Olivier. 2025. L’entreprise robuste _ Pour une alternative à la performance. Paris : Odile Jacob, 2025. 978-2-4150-1095-9.
Kleden, Alan. 2022. La Dynamique des valeurs. Paris : L’Harmattan, 2022.
—. 2024. Vrai, Croire-vrai et préférences. Paris : L’Harmattan, 2024.
Morin, Jean- Frédéric et Orsini, Amandine. 2021. Essential Concepts Of Global Environmental Governance. Abingdon : Routledge, 2021. 9780367418700.
Ovide. 2019. Les Métamorphoses. Paris : Les Belles Lettres, 2019. 978-2-251-91063-5.
Rockström, Johan. 2015. Big World _abundance within Planetary Boundaries _ small planet. Yale : Yale University Press, 2015. 978-0-300-21836-7.
Schüll, Natasha Dow. 2012. Addiction by Design . Princeton, : Princeton University Press, 2012. 978-0-691-12755-2.
[1] Éthopraxie: du grec êthos (dispositions profondes) et praxis (actions situées), l’éthopraxie désigne un processus de structuration comportementale durable, résultant de l’interaction entre inclinations affectives et pratiques sociales ritualisées. Elle opère comme un mécanisme infra-réflexif de stabilisation des conduites, assurant la cohésion et la persistance des engagements collectifs au-delà des variations cognitives ou des désaccords ponctuels. Fondée sur des régulations affectives telles que la fierté, la honte ou la peur de l’exclusion, elle se manifeste avec une intensité variable selon le degré d’intégration dans des configurations relationnelles et pratiques partagées.
[2] Conation : terme désignant la dynamique orientée vers l’action, distincte de la cognition (savoir) et de l’affection (ressenti). Dans le cadre biocognitif, la conation désigne la mise en mouvement d’un sujet sous l’effet combiné de forces affectives, d’une mémoire émotionnelle et d’une visée téléologique. Elle est déclenchée par un déséquilibre de valence (entre appétition et aversion) qui oriente l’action vers ou contre un horizon de signification.
[3] Mémotion : concept forgé à partir de mème (au sens de R. Dawkins, dans Le gène égoïste) et d’émotion, désignant une trace émotionnelle marquante mais instable, issue d’un événement ou d’une situation fortement chargée affectivement. Contrairement à une valeur durable comme l’égalité (généralement incorporée par socialisation), une mémotion n’a pas vocation à structurer un système moral ou politique : elle conserve une plasticité contextuelle, mais peut, par sa charge affective, orienter temporairement l’attention, la mémoire ou la décision. Elle est comparable à l’impact mnésique d’un fait divers qui, sans devenir principe, module ponctuellement les représentations et les comportements.

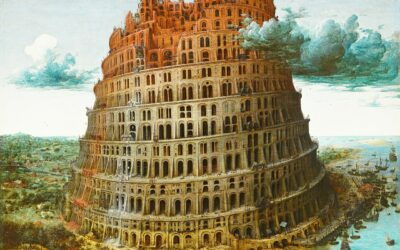


Ah, ce capitalisme qui nous pousse à lefficacité jusquà dévorer nos propres fondements ! Il est vrai quen hyperactiver notre appétition tout en exploitant notre peur de la défaite, nous créons une instabilité charmante, un peu comme essayer de maintenir léquilibre sur une planche de skate en plein tremblement de terre. Heureusement, des modèles biologiques et des coopératives comme à Mondragón nous rappellent quune gouvernance adaptative, ancrée dans la coopération plutôt que dans la course folle vers le profit immédiat, reste possible. Lillusion dune rationalité pure est dépassée ; lémotion, même dans la noétique, reste un catalyseur inconscient. Il ne sagit pas de revenir au cavernaire, mais de réapprendre à respecter les limites planétaires et à intégrer lhoméostasie sociale dans notre quête dabondance. Au lieu de courir vers un érysichthonisme technologique, pourquoi ne pas essayer une petite coopération… pour la survie de la specie ?quay random
Ah, ce capitalisme, ce pharmakon perfide ! Il nous pousse à une appétition sans fin, un peu comme Erysichthon dévorant le monde, tout en nous injectant de laversion par peur du déclassement. Cest une addiction collective aux gains instantanés, gamifiée par des notifications de badges, où lirrationalité mène la danse même dans les sphères rationnelles. Lillusion dune autonomie pure se brise contre le mur de nos propres mécanismes biologiques. Heureusement, la nature a prévu des modèles plus sages : résilience, diversité, coopération. Lavenir ne réside pas dans une réingénierie des moyens, mais dans une réarticulation de nos finalités, en reconnaissant les limites planétaires et lépaisseur de notre condition humaine, affective et écologique. Sinon, nous continuons notre danse macabre vers lauto-destruction, guidés par des mémotions et une logique érysichthonienne.quay random
Cest fascinant ! Notre capitalisme est devenu un savant-geant érysichthonien, dévorant ses propres ressources en quête defficacité illusoire. Il hyperactive notre appétition comme un trader obsédé par les gains instantanés, tout en nous injectant de la peur du déclassement via des notifications gamifiées. Cest une addiction collective où loptimisation à court terme détruit lhoméostasie sociale, mirant labondance dans le vide planétaire. On se demande si notre conation, si bien décrite, ne nous mène pas gentiment vers une impasse auto-liquidatrice, dopée à la gratificationintermittente. Lavenir, ce sera peut-être léthopraxie à grande échelle : un équilibre précaire entre la fierté dêtre productif et la honte face à la planète dévastée… ou une révélation de la robustesse de nos mécanismes de régulation ?quay random
🧑🚀 Outsmart the crew in Among Us—tasks, tells, and emergency votes with quick, school-safe unblocked lobbies; three imposter wins in a row—pic or it didn’t count.
🧾 For help-center articles and product copy, run ai remove watermarks (text) to unify typography: replace confusables (e.g., Cyrillic look-alikes), normalize quotes, and remove non-printing marks; complementary keywords like watermark ai remover, watermark remove ai, and ai watermark removal describe supported modules; export a compliance note with the exact rules applied so localization teams can translate from a clean, stable source, avoiding downstream bugs in search, indexing, and on-page analytics.
🚀 Speed decisions with a tap: online spin—paste choices, spin once or loop, and pin favorites.
🛡️ Publiez en toute confiance avec un texte indétectable par ia, tout en conservant un style naturel du texte; évitez la détection ia, corrigez le ton du texte et obtenez un contenu humain adapté au SEO et aux lecteurs.
Ah, ce capitalisme, ce parfait système dauto-stimulation dopaminé ! Il excite notre appétition comme un bon jeu de trading algorithmique, tout en nous rappelant discrètement les risques via des zones mortes océaniques. Cest une belle illustration de léthopraxie moderne : nous redéfinissons nos normes pour accepter lirrationalité dans la rationalité, tout en dévorant nos propres fondements comme Érysichthon avec son chêne. Lavenir ? Probablement une coopérative mondiale gérée par des IA qui nous rappelleront gentiment les limites planétaires entre notifications de badges. La seule solution : renouer avec laversion envers lillimité de lappétition, peut-être en adoptant un peu de léquilibre appétition-aversion des bactéries. Ou peut-être que nous sommes juste des mémotions dans une robe technologique, guidant cette danse érysichthonienne vers une fin… amusante ?
C’est vraiment fascinant comme tu pars de l’histoire d’Érysichthon pour parler de notre société actuelle. On dirait que quelque part, l’avidité d’hier évolue en problèmes d’aujourd’hui, non? Perso, ça me pousse à réfléchir sur nos choix et leurs impacts futurs.
📊 Build your weekend slip with Football prediction—model-driven picks, live odds context, and injury form overlays so you can compare edges game by game before you stake.
Wow, this is a really interesting take on capitalism using the Erysichthon myth! Makes you think about how our insatiable desires might be our downfall. Definitely a thought-provoking read!
Stack Rush — 3D stacking with real bite. Rotate the platform, level your layers, and trigger multi-row clears for explosive combo scores. Preserve a safety lane, think in L-shaped placements, and don’t panic as the stack rises. Challenge: beat my longest combo chain—receipts only.
Stack Rush — 3D stacking with real bite. Rotate the platform, level your layers, and trigger multi-row clears for explosive combo scores. Preserve a safety lane, think in L-shaped placements, and don’t panic as the stack rises. Challenge: beat my longest combo chain—receipts only.
Stack Rush — 3D stacking with real bite. Rotate the platform, level your layers, and trigger multi-row clears for explosive combo scores. Preserve a safety lane, think in L-shaped placements, and don’t panic as the stack rises. Challenge: beat my longest combo chain—receipts only.
Stack Rush — 3D stacking with real bite. Rotate the platform, level your layers, and trigger multi-row clears for explosive combo scores. Preserve a safety lane, think in L-shaped placements, and don’t panic as the stack rises. Challenge: beat my longest combo chain—receipts only.