Il est de coutume de juger l’œuvre de Pierre Boutang, pour l’en louer ou l’en blâmer, peu importe, à l’aune de sa fidélité à Charles Maurras. Pierre Boutang ne cessa jamais, à l’inverse de tant d’autres, de mentalité honteuse ou renégate, de témoigner d’une fidélité essentielle à l’égard de l’auteur (enseveli sous l’opprobre, le mépris et l’indifférence) de L’Avenir de l’Intelligence.
Être fidèle à Charles Maurras, ce ne fut certes point, pour Pierre Boutang, de s’obstiner, à l’exemple de quelques acariâtres, sur les vues partielles défendues par le Maître de Martigues dans tel ou tel éditorial malencontreux, mais bien d’accomplir cet acte de remémoration et de gratitude par lequel le disciple établit l’autorité du Maître dans son essence, sans pour autant éprouver la tentation psittaciste de la redite pure et simple, sans âme, qui accable l’œuvre sous le poids de la lettre morte. Villiers de l’Isle-Adam dans un conte intitulé Les Plagiaires de la foudre traite la question sous forme de parabole.
Rien n’est moins aimable que le reniement. Déprécier le passé du monde, de son pays, ou ne fût-ce que de sa propre existence est, selon Nietzsche, le signe propre du nihilisme. Celui qui renie son passé ne fonde point le nouveau mais l’abolit. L’idée même d’un couronnement des formes, d’un accomplissement du destin, d’une réalisation, au sens métaphysique, voire initiatique du destin, suppose que l’âme humaine, amie de Mnémosyne, ait construit, pierre à pierre, et avec déférence, un édifice du Souvenir.
Être fidèle, ce n’est point idolâtrer le passé, c’est veiller sur la flamme, dispensatrice à la fois de chaleur et de lumière, afin qu’elle ne s’éteigne. Témoigner d’une fidélité essentielle, c’est comprendre la différence, qui désormais échappe aux modernes, entre le Maître qui nous fait disciple (de même que par une élection qui n’a rien de démocratique, nous le faisons Maître) et le Maître qui nous fait esclave. Être fidèle, c’est atteindre à cette liberté essentielle, caractère dominant de l’auteur Pierre Boutang, liberté qui est le « privilège immémorial de la franchise », le signe de l’attachement de l’auteur à son Pays qui lui permet d’être lui-même, sans pour autant être maurrassien à la façon des épigones et des intégristes : ces nuances échapperont aux esprits mécaniques.

« Ainsi chaque réel poème a pour invisible réserve, ce que le Moyen Age nommait vox cordis, une voix du cœur »
Pierre Boutang
Le moindre mérite de Pierre Boutang, disciple et non esclave, sera, sans craindre outre mesure la police du politiquement correct, de rendre possible une exploration de la nécessaire convenance du monde au langage qui l’élucide et l’enchante et, par voie de conséquence, de la tradition, et l’art du traducteur, qui témoigne de l’autorité du Sens.
Dès lors que l’on ne cède point à la superstition ou à l’idolâtrie du texte réduit à sa propre immanence, comme il était d’obligation dans les sectes de la critique matérialiste des années 60, il devient légitime de s’interroger sur les fonctions, non plus de l’écriture, mais de l’auteur, au sens jüngérien. Les fonctions de l’auteur sont de l’ordre de son magistère.
Dans la perspective métaphysique ou plus exactement théologique, qui ne cessa jamais d’être celle de Pierre Boutang, même au cœur le plus ardent de son combat politique, l’œuvre est un moyen de connaissance et de justice, et relève par voie de conséquence, de ces fonctions, incarnées dans la culture hindoue par les brahmanes et les kchatryas, fonctions de prêtres et de héros (et qui nous parlent encore selon le mot de Novalis, du « mystérieux sanscrit de l’âme ») que les civilisations traditionnelles considéraient comme supérieures aux fonctions économiques ou purement utilitaires.
Si la fonction dévolue à quelques écrivains est de distraire, à d’autres, moins enviables, de relever la bonne conscience défaillante de leurs lecteurs, à d’autres encore plus simplement de passer le temps, comme si le temps n’accomplissait pas cette fonction de son propre chef, les fonctions de l’œuvre de Boutang sont infiniment plus complexes et d’une portée si grande que nous parions volontiers qu’elles ne commencent qu’à peine à être évaluées.
Pierre Boutang, logocrate, monarchiste, philosophe et traducteur, fit donc de chacune de ses vertus au sens antique, une fonction, au sens sacerdotal.
Être monarchiste, pour Pierre Boutang, loin d’être seulement l’expression d’une conviction, ce fut une poétique et une rhétorique, au sens noble, médiéval et théologique, c’est-à-dire la façon, également grammaticale et étymologique tout autant qu’architecturale et musicale, de comprendre l’ordre humain et l’ordre du monde en concordance avec l’ordre divin. Alors que le monarchisme de beaucoup d’autres n’est qu’une façon retorse d’avouer leurs nostalgies d’un monde réduit précisément aux valeurs de la troisième fonction, au sens dumézilien, travail, famille, patrie, c’est-à-dire aux valeurs bourgeoises, dans toute leur horreur, à laquelle s’ajoute le goût obscur pour la défaite, la contrition, et une forme vaniteuse d’irresponsabilité ; pour Pierre Boutang, au contraire, être fidèle au Roi, c’est d’abord se souvenir que la France, par provenance, et osons le croire par destination, est un Royaume, et que la République (dont il est permis à présent de préférer l’aristocratisme jacobin, d’allure encore vaguement stendhalienne, à l’actuel totalitarisme démocratique) s’est elle-même faite avec ce Royaume dont elle décapita les Symboles.
Être monarchiste, pour Pierre Boutang, c’est comprendre, par-delà les considérations positivistes (inspirées d’Auguste Comte, d’Anatole France ou de Renan) de Maurras, que l’ordre politique et terrestre n’est digne d’être respecté que s’il reçoit humblement l’empreinte de l’Ordre du Ciel. La fonction d’Auteur monarchique que Pierre Boutang fut, avec Henry de Montaigu, un des très rares à hausser à l’exigible dignité chevaleresque, annonce ainsi sa fonction de philosophe, c’est-à-dire d’amoureux de la sagesse. Car si l’Ordre est vénérable, en ce qu’il témoigne du permanent, et s’il est préférable a priori à la subversion, désastreuse par nature, il n’en demeure pas moins que Pierre Boutang, dans la fameuse querelle sur le coup de force qui eût libéré Socrate de ses geôliers, fut enclin à passer outre aux recommandations légalistes de Socrate pour le sauver. L’Ordre est sacré, certes, mais encore faut-il qu’il ne contredise point le cri du cœur qui, en certaines circonstances, nous en révèle la nature parodique.
Dans la honte et l’horreur où nous plonge le désastre du monde moderne, le grand péril est de céder à n’importe quelle réaction, de nous contenter d’un ersatz. Mieux vaut approfondir en soi l’absence du Royaume, de l’Ordre, du Sacré que d’en faire un simulacre. Les temps modernes sont aux faux-semblants. Des fausses légions romaines de Mussolini ou de Hitler aux châteaux en carton-pâte des parcs d’attraction d’outre-Atlantique venus s’installer chez nous, la ligne constante du monde moderne est de substituer le faux spectaculaire à « la simple dignité des êtres et des choses ».
Amoureux de la sagesse, le philosophe est aussi amoureux du langage qui porte en lui, comme un secret et une évidence, les Normes de la sagesse. Pierre Boutang se déclara lui-même logocrate. C’est qu’en effet le pouvoir du Logos accroît notre liberté et notre autorité. On peut lire ainsi toute l’œuvre de Pierre Boutang comme une méditation sur le Logos incarné. Être auteur, c’est remplir ces fonctions de l’auctoritas non sans un certain détachement (Julius Evola dirait une impersonnalité active) accomplir son destin, faire son œuvre, être à la hauteur de cette disposition providentielle dont la surnature nous privilégie et dont tout combat humain n’est que la remémoration ou le remerciement.
Les talents ne sont pas donnés en vain et comme les hommes plus généreux sont aussi les plus prompts à révéler leurs talents, il est compréhensible que l’écart se creuse entre les hommes et leurs œuvres. Mais cette inégalité est avant tout, pour reprendre le mot de Maurras, une inégalité protectrice. La méditation sur la Monarchie, sur le pouvoir du Logos et sur la rhétorique de Dieu que Pierre Boutang poursuit à travers son œuvre ne sera point sans redonner, au grand scandale des bien-pensants, un sens profond, et dirions-nous profondément chrétien, au mot hiérarchie.

Parmi les rares écrits anglais trouvant grâce aux yeux de Maurras figurait le Colloque entre Monos et Una d’Edgar Poe qui comporte, il est vrai, l’une des critiques métaphysiques les mieux formulées de l’idéologie démocratique : « Entre autres idées bizarres, celle de l’égalité universelle avait gagné du terrain, et à la face de l’Analogie et de Dieu, en dépit de la voix haute et salutaire des lois de gradation qui pénètrent si vivement toutes choses sur la Terre et dans le Ciel, des efforts insensés furent faits pour établir une Démocratie universelle ».
Nous comprenons, à lire Poe, qu’en dernière analyse, ce qui distingue les hommes en accord avec les profondeurs du temps et les derniers hommes au sens nietzschéen, ceux qui clignent des yeux, c’est d’abord le sens des gradations.
Ce sens des gradations qui est d’abord résistance à la planification entreprise par le monde moderne sera aussi une clef pour comprendre sans tomber dans les lieux communs universitaires, la pensée platonicienne de la Forme et du Logos dont Pierre Boutang ravive les prestiges et approfondit pour nous les possibilités. Il existe une façon matutinale d’être platonicien, de faire de la pensée un chant de gratitude dans le matin profond, et cette façon, cette poétique, en référence à l’étymologie du faire poétique, nous délivre de ce dualisme morose où certains universitaires voulurent enfermer l’œuvre de Platon et de ces disciples.
De même que Pierre Boutang eût été tenté de sortir Socrate de sa geôle, il saura prendre les mesures nécessaires pour sortir Platon de sa prison exégétique où, non sans les commodités propres aux prisons modernes, Platon se trouve réduit à une perpétuité de mauvais aloi. L’œuvre de Pierre Boutang est ainsi la réfutation d’un nombre considérable de banalités fallacieuses. A commencer par la plus insistante de toutes qui consiste pour le premier venu à prétendre au renversement du platonisme. La belle affaire que de renverser !
Sans doute y a-t-il là de quoi satisfaire à la fois au goût moderne de la subversion et à l’indéracinable vanité humaine. Pierre Boutang en renouant avec une subtilité herméneutique perdue avec l’avènement de la science moderne est sans doute, avec Henry Corbin et George Steiner, celui des philosophes qui nous offre l’ultime chance de comprendre que ce platonisme toute orientation.
Si nous ne pouvons nier la Forme, et que toutes les choses ont une forme qui correspond à un modèle, il demeure possible de contester ce que l’on suppose être l’intention de la métaphysique, qui est d’affirmer la précellence de l’Un et de l’Éternel sur le multiple et le fugace. Or, le monde moderne a ceci d’étonnant qu’il choisit ses chantres parmi les hommes qui ne cherchent que le renversement. Cette prétention, qui se voudrait nietzschéenne et qui n’est que bonhommesque, n’est qu’une caricature. Poursuivant avec audace et humilité la méditation européenne sur la Forme et le Logos sans faire système ni doxa de ce qui ne s’y prête point, Pierre Boutang exige de son lecteur cette témérité et cette déférence qui, selon la formule d’Hölderlin, fondent ce qui demeure. Les philosophes modernes, loin d’avoir renversé le platonisme se sont contentés d’en fermer l’accès, d’en rendre l’approche impraticable par des approximations et des sophismes.
Ainsi en est-il de la confusion assez systématiquement entretenue entre l’opposition et la distinction. Platon distingue car distinguer est le propre de la connaissance et l’art du poète comme du métaphysicien. De même que le musicien distinguera le timbre, le rythme et la mélodie, sans davantage concevoir qu’on dût les séparer, Platon distingue les idées et les réalités sensibles comme Julius Evola, l’un de ses lointains disciples, distinguera la forme de la matière. Platon lui-même parle des gradations infinies qui unissent les mondes que l’exigence de la connaissance distingue. Il y a dans l’insistance des modernes à renverser le platonisme une volonté déterminée de ne pas comprendre la Forme, le Logos et l’Un qui fondent la métaphysique et l’ontologie européennes. Le grand mérite de Pierre Boutang sera de renouer la catena aurea qui nous unit à Platon, Parménide, Aristote et à la théologie médiévale après laquelle une grande part de l’ingéniosité humaine consistera à déraisonner de façon de plus en plus utilitaire.
L’Idea, la Forme, au sens platonicien, ne se réfute qu’au profit d’un nouvel obscurantisme, peut-être le pire de tous, qui délie, scinde, déconstruit, d’une relativisation générale qui, récusant la notion d’interdépendance universelle n’est plus qu’une méthode pour nier tout sens et la plus vive aversion pour la communion des esprits. Nier l’éternité, le Logos, l’Un, c’est rendre impossible la communion des esprits, c’est rejeter dans une multiplicité fractionnante à l’infini un message réduit à sa propre immanence et vouée à ne signifier fugacement que dans un temps ou dans un lieu donné. Sous couvert de dénoncer toute hiérarchie, y-compris celle qui, par gradations infinies, embrasse toute chose dans un même amour (ou dans une même logique), et de refuser toute Autorité (y-compris celle qui est contre le pouvoir, dont la nature est d’abuser, le seul recours de la liberté), le Moderne invente un monde où la communion cède définitivement à la fascination, où les signes et les symboles réduits à eux-mêmes deviennent idoles et où la solitude, n’étant plus glorifiée par l’unificence Dieu, n’est plus que l’esseulement de l’insolite, de l’unité interchangeable, propre à cet individualisme de masse qui parachève les ambitions les plus folles du totalitarisme.
Ce n’est pas le caractère le moins diabolique de ce siècle étrange que d’avoir généralisé la communication tout en ôtant aux hommes la possibilité de la communion. Exception lumineuse, la rencontre de Pierre Boutang et de George Steiner, fut bien davantage qu’un heureux hasard médiatique. Pour peu que l’on cultive quelque peu, à l’exemple du bon maître d’Engadine, le goût de la généalogie des idées, l’importance au cœur des œuvres de Boutang et de Steiner, d’une théorie de la traduction, ne manquera pas d’apparaître dans sa perspective métaphysique. La riposte steinerienne à Derrida et à quelques autres, qui persistent à refuser le Sens comme une déplorable survivance platonicienne, vient ainsi étayer dans notre pensée l’Art poétique de Pierre Boutang, comme de juste dédié à Steiner, et qui est d’abord un traité de la traduction.
Que la traduction soit possible, nous dit Steiner, prouve l’existence du Sens. Non point d’un sens comme épiphénomène, prolongement du fonctionnement du texte mais comme origine, voire comme mystère dont il reviendra à l’Art poétique de manifester la présence réelle. L’insistance du moderne à nier la possibilité ou la légitimité de la traduction, toute traduction s’avérant pour lui inadéquate ou délictueuse, n’est rien moins qu’innocente car à suivre le raisonnement de Steiner et celui de Boutang, si nous pouvons traduire, toute la doxa moderne et matérialiste se trouve récusée ! Si le Sens existe, s’il se manifeste en présence réelle, ainsi que l’établit la simple possibilité de la traduction, l’intelligence même du mouvement renoue avec l’herméneutique, et, par voie de conséquence, avec la Tradition.
Ce qui peut être traduit, cette possibilité universelle du Sens, tel est le fondement de l’herméneutique et de la Tradition. Interpréter, traduire, transmettre, telles sont, pour l’homme traditionnel, les fonctions essentielles de l’entendement humain, et l’aventure par excellence dont la navigation d’Ulysse est la métaphore immense ! Ce qui peut être traduit navigue sur le vaisseau du langage dont les cordes, les voiles et le bois sont la grammaire. L’herméneute est celui qui fait sienne cette beauté maritime, qui veille sur les variations météorologiques révélées par les souffles et les couleurs. Celui qui aborde un poème avec un coeur moins aventureux demeurera en-deçà de l’honneur que la Providence lui fait d’une telle rencontre. Comme dans toutes les circonstances majeures de l’existence, tout se joue dans la déférence. S’orienter dans les ténèbres des signes réduits à eux-mêmes, jusqu’au matin, tel sera le courage du traducteur.

Avant de traduire d’une langue à une autre, dans ce monde d’après Babel où nous sommes précipités de naissance, le traducteur traduit du silence qui est en amont de l’œuvre. Toute traduction est ainsi non seulement herméneutique, elle est aussi gnostique, à la condition de comprendre que le mot gnose ne renvoie pas ici aux théogonies des sectes d’Alexandrie qui voyaient en la création l’œuvre du démon, mais à la Connaissance, la gnosis que Platon distingue de l’opinion, de la doxa.
Ce que le Moderne nie en niant la possibilité de la traduction, n’est rien d’autre que la tradition dont l’œuvre de Pierre Boutang décrit, avec faste, les ramifications et les arborescences. Enfermer chaque langue dans la prison de ses mécanismes, et chaque auteur dans le cachot de sa subjectivité intransmissible, soumettre les idées, les métaphysiques, les symboles et les mythes à des circonstances sociologiques, en un mot, expliquer le supérieur par l’inférieur, au point d’ôter à l’esprit toute réalité, telle est l’ambition du monde moderne qui ne peut établir son règne totalitaire qu’à ce prix. C’est à ce titre que l’on cherche depuis plusieurs décennies à nous faire croire que Platon, Dante, Shakespeare nous sont devenus incompréhensibles afin qu’ils le deviennent et que nous soit ôté ce lien aux gloires et aux autorités d’antan où nous puisons la force de résister aux offenses et aux pouvoirs d’aujourd’hui.
Ne rien voir que le mécanisme des êtres, des œuvres et des choses, c’est hâter le moment où tous les êtres, toutes les œuvres et toutes les choses seront entièrement livrés à un mécanisme. A l’analyse et à l’explication où le moderne accomplit sa vocation titanique, Pierre Boutang oppose l’interprétation et la compréhension des gradations. A travers ses traductions de l’Ecclésiaste, de Sophocle, de Shelley ou de Rilke, Pierre Boutang fait l’expérience, non de mécanismes mais « d’une poésie secrètement unique dont il est naturel ou surnaturel qu’elle passe tout entière, non sans métamorphose, dans d’autres langues humaines parce qu’elle est la langue des dieux. Et puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu, il faut que ce soit parce qu’elle est poésie et non prose ».
Le rapport essentiel qui rend possible ce périple odysséen que sera l’herméneutique créatrice, ne sera donc point celui qui s’établit, ou manque à s’établir, entre le poète traduit et le poète traducteur, ou entre la langue d’origine et la langue destinée mais, plus profondément, entre le poème et l’Auteur. « L’être du poème à traduire, écrit Pierre Boutang, n’est de personne, il est comme le poème, présent dans sa langue – au point décisif de l’expérience ». Cette affirmation suffit à elle seule à marquer le différend qui oppose Pierre Boutang à la presque totalité des critiques qui furent ses contemporains. Loin de lancer devant soi l’être du poème ou quelqu’audacieuse et peut-être salvatrice hypothèse ontologique, la critique moderne fit de son mieux pour dénier à la poésie tout être, voire toute existence, à la rendre dépendante, non seulement de l’humain mais d’un humain défini selon des critères strictement déterministes.
Qu’il y eût être du poème et donc, de la part du poète, comme du traducteur, la possibilité d’une gnose et d’une ontologie poétique, c’est bien là une hypothèse qui, non seulement ne fut pas envisagée mais dont il parut nécessaire, pour d’évidentes raisons d’orthopraxie matérialiste, d’exclure toute approche possible. Telle est la sereine fulgurance de Pierre Boutang, en concordance avec sa fidélité, de nous faire comprendre que le poète est à la poésie ce que l’homme est à Dieu, le plus simplement du monde « un éclair dans un éclair » selon la formule étonnante d’Angelus Silesius. « Le traducteur auprès de cet être, écrit Pierre Boutang, ne diffère pas foncièrement du poète, lui-même effacé par son ouvrage ». Le tout est d’entendre ce qui est dit. A peine sommes-nous présents à notre entendement que nous devenons l’infini à nous-mêmes. Les vertus réfléchissantes de notre spéculation que la vérité métaphysique embrase, comme un soleil à la surface des eaux, s’incarnent dans le Chant. Dans les éclats illustres de cette transcendance immanente, nous abandonnons l’illusion dérisoire d’un poème issu de l’humain pour rejoindre l’élan de l’hypothèse audacieuse, odysséenne, d’une poésie reçue des dieux ou de Dieu !
Certes, l’être simple du poème, en tant que pure transcendance, est au-delà de la subjectivité et de l’objectivité, de même qu’il ignore l’opposition coutumière entre l’intérieur et l’extérieur. Toutefois, la façon la moins malencontreuse d’aborder le poème est encore de commencer par lui reconnaître cette grande vertu d’objectivité, où le Moi s’efface, et qui est le propre des natures héroïques et sacerdotales. L’œuvre de Pierre Boutang et celle de Henry de Montaigu se rejoignent là encore pour reconnaître dans cette vertu une prédestination surnaturelle de la langue française dont Boutang souligne « l’universalité et la vocation à traduire les proses de Babel et à les attirer sur un terrain commun ». Une fois dépassées les contingences, par l’immensité des désastres qui survinrent, l’action française ne saurait plus être qu’une action du Logos français, une action oblative, c’est-à-dire une prière du cœur d’où naissent surnaturellement les prosodies de Scève, de Nerval et d’Apollinaire ! Pierre Boutang en témoigne : « La langue française ne devrait d’abord établir ses titres et son privilège que dans la traduction du poème et de tout ce qui demeure d’héroïque et de divin dans l’existence des hommes de toute origine ». L’universalité métaphysique non seulement ne dénie pas cette disposition providentielle, elle en accomplit la vocation profonde.
Luc-Olivier d’Algange

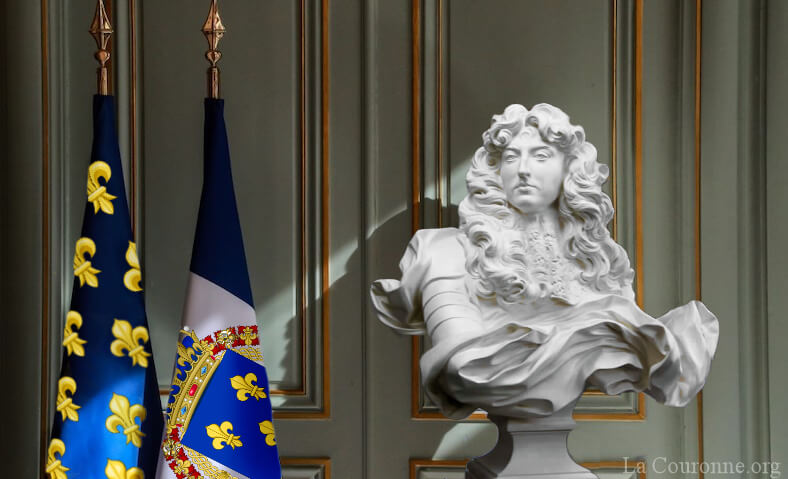


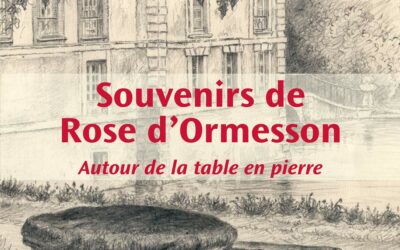
0 commentaires