Une thèse voit actuellement le jour en France pour accréditer l’idée que le « camp Trump » ferait un usage illégitime de l’œuvre de René Girard. Cette thèse est relayée par une émission de France Culture et un article de la revue Esprit.
L’émission de France Culture du 3 mars dernier (Chloé Leprince Production), retranscrite sur le site Radio-France, a pour titre :
« Comment le camp Trump a fait une OPA sur le philosophe René Girard : braconnage, appropriation, hors les murs ».
La première phrase du propos qualifie Girard de « Penseur catholique réactionnaire… ». Sans soupçonner le caractère fortement antithétique de cette dernière expression, l’auteur confirme ce jugement en affirmant plus loin que « Girard est certes un penseur réactionnaire, mais chrétien ». Pour réfuter ces deux affirmations, il suffit de renvoyer à l’ouvrage Christianisme et modernité (trad. franç., Flammarion, 2008) que Girard a écrit avec Gianni Vattimo, grand philosophe et homme politique italien, d’obédience socialo-communiste, qui devait se convertir au catholicisme à la suite, précisément, de la lecture de Girard. Certes Girard lui-même rappelle qu’il a souvent été traité de « farouche réactionnaire », mais en ajoutant aussitôt qu’il a été également, non moins souvent, qualifié de « dangereux révolutionnaire » – deux accusations qui, évidemment, s’annulent mutuellement.
Dans la suite de la même première phrase, Girard est gratifié du titre de « pourfendeur de la bien-pensance » – ce qui est parfaitement exact – puis reconnu comme « la référence mise en avant par Peter Thiel, milliardaire de la tech, mentor du vice-président J.-D. Vance ». Thiel fut l’élève de Girard dans les années 1980, quant à Vance, c’est à la suite d’une conférence de Thiel sur Girard qu’il devait se convertir au catholicisme (un peu comme Vattimo).
Mais la plus grande partie du propos est consacré à l’usage qu’avait fait naguère Pierre Bourdieu (en 1967) de Panovsky pour son grand ouvrage Architecture gothique et pensée scolastique (laissant entendre que cet usage n’est pas plus sérieux que celui que fait le camp Trump de Girard). Le reste, fort ténu, du propos consiste à dénoncer la brutalité du camp Trump (incompatible, selon l’auteur, avec la vision de Girard qui pourtant reconnaît que l’on ne vient à bout d’une violence que par une autre violence) – brutalité qui a éclaté au grand jour lors de l’épisode du bureau ovale du 28 février !
Aussi n’est-il pas étonnant qu’après avoir rappelé la volonté du « camp Trump » de revendiquer, à son propre compte, l’héritage de René Girard, l’auteur termine sa présentation par la remarque suivante : « Sauf que les girardiens, eux, parlent d’un usage peu scrupuleux de René Girard » – ce qui est confirmé par la conclusion même du propos : cet usage « apparaîtra bien a minima comme une caricature », voire une véritable prédation.
La question est de savoir quels sont ces « girardiens » auxquels se réfère l’auteur ? La réponse est donnée, en cours et en fin de propos : il s’agit principalement, pour ne pas dire exclusivement, de Bernard Perret pour son article de la revue Esprit de septembre 2024 :
« Le pessimisme est-il forcément réactionnaire ? Contre la récupération de René Girard par la droite américaine ».
Il faut donc se pencher sur cet article. L’auteur se propose d’aborder l’influence de « la droite chrétienne, y compris catholique, sur la politique américaine ». Cette influence présente deux caractères (correspondant aux deux parties de l’article) : « le souci de la vertu » et la dénonciation de « l’impasse moderne ». Nous rappellerons la position de l’auteur sous la rubrique question (Q), puis la réponse (R) que nous pouvons y apporter.
I « LE SOUCI DE LA VERTU »
- Q.
Par « le souci de la vertu », la droite chrétienne, conservatrice, libertarienne et trumpienne entend partir en guerre contre « la démocratie, l’ordre juridique, l’Etat démocratique ». Cette vindicte vise surtout « l’Etat redistributif (la fiscalité progressive, l’Etat providence) », d’où « la promotion des vertus privées au détriment des vertus publiques » et le refus de « considérer les pauvres comme des victimes ». En un mot, il s’agit de faire passer « le bien-être moral avant le bien-être matériel ». Cette critique est, bien entendue, opposée à « la doctrine sociale catholique du bien commun, d’une justice sociale ».
- R.
En refusant de « considérer les pauvres comme des victimes », le camp Trump, conformément à l’enseignement de Girard, échappe à la « victimologie contemporaine », à cette « surenchère perpétuelle » qui consiste à voir des victimes partout et qui constitue une dérive du légitime « souci moderne des victimes » – souci qui est, bien sûr, d’origine chrétienne, mais qui connaît une forme pervertie et dégradée, justifiant le mot de Chesterton « le monde moderne est plein de vertus chrétiennes devenues folles ».
Car le « souci des victimes » a donné lieu, selon Girard, à « une injonction totalitaire, une inquisition permanente, tout en prenant des formes souvent aberrantes », le plus remarquable étant le caractère fondamentalement anti-chrétien qu’il a adopté. En outre aujourd’hui, avec la mondialisation, le « souci des victimes » s’étend à la terre entière et devient notre principal devoir. Or, par une sorte d’effet pervers, il fait l’objet d’une recherche permanente de victimes toujours nouvelles (« l’obsession victimaire », la « victimologie ») qui transforme ces chercheurs de nouvelles victimes, eux-mêmes, en véritables persécuteurs (Quand ces choses commenceront…, Arléa, 1994, p. 63).
II « L’IMPASSE MODERNE »
- Q.
La dénonciation de « l’impasse moderne » consacre un retour au fascisme tel que décrit par Nidesh Lawtoo de l’Université de Leyde, dans son ouvrage (New) Fascism, Michigan State University Press, 2019. « L’anthropologie mimétique de René Girard est un bon outil pour repérer les proximités entre le trumpisme et le fascisme des années 1930 en tant que stratégie d’utilisation des moyens de communication dans un but anti-démocratique ». Le « fascisme (ancien ou nouveau) » est en effet « une entreprise de création d’unanimité par négation des différences, l’utilisation anti-démocratique des réseaux sociaux pour arriver à une identité collective : tel est « le telos moteur du fascisme » qui est « l’un des effets de la mimésis ». Ce qui permet de « créer une communauté contagieuse, un collectif organique, indifférencié, violent et potentiellement guerrier ».
Dans cette création, si les moyens de communication de masse des années 1930 ont parfaitement joué leur rôle anti-démocratique pour toucher un public vulnérable, il est à craindre qu’aujourd’hui les nouveaux médias ne jouent le même rôle, surtout lorsqu’ils sont manipulés de main de maître par la « communication de Trump ».
- R.
Que le fascisme soit, selon Lawtoo, « une entreprise de création d’unanimité » est incontestable et conforme à la théorie mimétique de Girard : là-dessus, tout le monde est d’accord. En revanche ce qui est plus problématique, c’est que selon Girard, « l’entreprise de création d’unanimité » est à l’origine de toute souveraineté, de tout régime politique, y compris de la démocratie et de son assise sur le « contrat social ». Pour Girard en effet, le fondement de la société réside dans le sacrifice d’un bouc émissaire, pour mettre fin à un état de violence : telle est l’origine violente de toute société attestée par Caïn et Abel pour le peuple juif, Etéocle et Polynice pour le peuple thébain, Rémus et Romulus pour le peuple romain. Mais, pour que le sacrifice ait lieu, il faut un accord unanime de la communauté : la vérité de la « violence fondatrice » requiert une « violence unanime » qui procède de la collusion du peuple et des élites. De cette collusion, Girard donne deux exemples frappants tirés des Evangiles : celui d’Hérode qui voudrait sauver Jean-Baptiste, et celui de Pilate qui voudrait sauver Jésus ; mais, dans les deux cas la pression mimétique est trop forte, celle des convives qui réclament la tête de Jean-Baptiste, celle de la foule qui réclame de livrer Jésus et non Barabbas (La voix méconnue du réel, Grasset, 2002, p. 186). Or cette collusion du peuple et des élites comme preuve et épreuve de l’unanimité, se retrouve à l’origine de tous les régimes politiques, y compris des plus démocratiques car le « contrat social » se noue au moment où la « violence unanime » trouve son bouc émissaire. Si donc « l’anthropologie mimétique de Girard est, selon Lawtoo, un bon outil pour repérer les proximités entre le trumpisme et le fascisme des années 1930 », elle n’est pas un plus mauvais outil pour repérer les mêmes proximités entre le trumpisme et les régimes prétendus les plus démocratiques d’hier et d’aujourd’hui.
En outre, si le fascisme comme le trumpisme est, selon Lawtoo, « négation des différences » pour aboutir à un « collectif indifférencié et violent », l’indifférenciation serait un point commun entre trumpisme et fascisme. Dans ce cas, comment expliquer que le camp Trump ait fait de la lutte contre le wokisme une priorité de son programme ? Car le wokisme est bien le plus haut porte-parole de l’indifférenciation, la plus puissante machine de guerre jamais dressée contre toute différence de race, de culture, de sexe. En ce sens, c’est le trumpisme, et non pas le progressisme, qui est fidèle à l’enseignement de Girard. Pour Girard en effet « l’indifférenciation », l’effacement des distinctions attise la « rivalité mimétique », provoque la confusion des rôles et la prolifération des doubles « dont le rêve est de s’entrégorger », elle est source de conflits et génératrice de violence. Selon la remarque d’Alfred Simon (« Les masques de la violence », in La violence et le sacré, Grasset, Pluriel, 1972, p. 520), « il faut saisir l’indifférenciation comme violence, ce que ne fait pas la pensée moderne qui, égalitaire dans son principe, voit au contraire dans la différence un obstacle à l’harmonie entre les hommes ». Ainsi l’indifférenciation vise-t-elle à cacher le « meurtre collectif », la « violence fondatrice ».
CONCLUSION
- Q.
Par « le souci de la vertu », la droite conservatrice préconise un retour à l’initiative individuelle et à la vertu privée contre toute forme de justice sociale – ce qui va à l’encontre de la doctrine catholique.
La dénonciation de « l’impasse moderne » témoigne d’un véritable pessimisme sur l’avenir et la démocratie, sur l’action collective organisée – à cet égard, elle peut se nourrir de la critique de l’optimisme progressiste chez Girard. En revanche, à l’encontre de la théorie mimétique, le trumpisme cristallise « les pathologies contemporaines du politique : l’hyper-libéralisme, l’hybris technologique, l’usage irresponsable de la communication numérique, du conservatisme moral, du fondamentalisme religieux, du nationalisme et du populisme, aux Etats-Unis et ailleurs ».
- R.
Certes la théorie mimétique peut servir à dénoncer les différentes « pathologies contemporaines » énoncées par l’auteur puisque toutes procèdent d’une « contagion mimétique ». Cependant, dans la liste dressée précédemment, toutes ne relèvent pas systématiquement de la « mauvaise mimésis », celle qui engendre la violence. Trois « pathologies contemporaines » peuvent échapper à la « mauvaise mimésis » et rejoindre la « bonne mimésis », celle qui engendre de bons rapports entre les individus, les groupes et les peuples (dans ce cas, elles sont plus des « thérapeutiques » que des « pathologies » !) : il s’agit, correctement compris, du « conservatisme moral », du « nationalisme » et du « populisme ». En effet le « conservatisme moral » peut renvoyer à la sagesse accumulée par les générations précédentes, ce que les éthologues appellent la « tradition cumulative », ce que Hayek appelle « l’évolution culturelle » prenant acte des « idées couramment admises sur ce qui est juste », c’est-à-dire des « règles de juste conduite » de « l’ordre spontané ». Quant au « nationalisme » et au « populisme », malgré la connotation actuelle fort péjorative des deux termes qui renvoient systématiquement à la « mauvaise mimésis », ils peuvent aussi procéder de la « bonne mimésis » lorsque les nations et les peuples ne sont pas dressés les uns contre les autres, mais coopèrent pacifiquement les uns les autres, pour le plus grand bien de l’humanité – ce qui est d’ailleurs le véritable idéal du droit international. Mais il est vrai que l’état actuel du monde est aux antipodes de cette vue idyllique, surtout en France, où, comme le dit Charles Gave, « la gauche a trahi le peuple, et la droite a trahi la Nation » – le discrédit du populisme et du nationalisme n’étant que le masque de cette double trahison.
Ainsi le camp Trump, à l’enseignement des Evangiles et à l’instar de Girard, n’est pas plus réactionnaire que pessimiste. C’est non seulement contradictoire mais en plus aberrant d’associer le christianisme au réactionnaire et au pessimisme : le Christ est venu annoncer « la bonne nouvelle », les temps nouveaux et la promesse du Royaume de Dieu – selon Girard, le Christ a mis fin aux religions archaïques, au sacrifice d’innocentes victimes : voilà ce qui est nouveau et plein d’espérance, voilà ce qui fait la modernité et la joie de l’Evangile. Le christianisme refuse seulement la perspective « des lendemains qui chantent » au profit d’une attitude apocalyptique au vrai sens du terme, celui d’attente de la Révélation. Ce qui donne l’apparence de pessimisme, c’est que notre histoire est, selon Girard, semblable à celle des pèlerins d’Emmaüs (Des choses cachées depuis la fondation du monde, Grasset, 1978, p. 302-303), elle est attente, expectative, interrogation, doute et même parfois découragement, tant que Jésus n’a pas parlé en chemin et expliqué les Ecritures, tant qu’il n’a pas partagé, avec chacun, son savoir et son pain – ce qui justifie pleinement le mot du Père Bruckberger : « Nous sommes dans le Samedi Saint de la Création ».


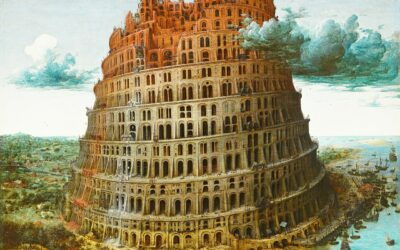

0 commentaires