La première partie du texte témoignage d’Arnaud Imatz sur les évènements de mai 68 – De l’université à la caserne. La profonde transformation du début des années 1960. À l’occasion du 50e anniversaire des événements de mai 68, les journalistes n’ont pas manqué de placer l’ensemble de la génération de 68 sous le signe de la contestation «de l’ordre établi, de la hiérarchie et du moralisme gaulliste». Mais la réalité est évidemment plus subtile et complexe. Avant de décrire et d’analyser ces événements, j’apporterai ici le témoignage discordant du jeune étudiant et soldat que j’étais alors.
De l’université à la caserne
Je n’ai pas été un acteur direct des événements de mai 1968, mais seulement un «spectateur» tardivement «engagé». Je venais d’avoir 20 ans et j’étais étudiant en économie à l’Université de Bordeaux. Je sympathisais avec les jeunes gaullistes, mais sans pour autant militer dans leurs rangs. Je me souviens avoir participé à des campagnes électorales dans les Pyrénées-Atlantiques, notamment, avoir collé des affiches entre Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, en faveur du candidat gaulliste, Bernard Marie (ex-arbitre de rugby du Tournoi des cinq nations et père de Michèle Alliot-Marie), lors des élections législatives de juin 1968. Ces affiches reproduisaient l’image de voitures brûlées et disaient, à propos des émeutes de mai, «Plus jamais ça!».
Le mouvement de protestation étudiante de mai 68 a été pour moi un véritable révulsif. Si cette rébellion gauchiste, de leaders trotskistes, castristes, guévaristes, maoïstes, situationnistes, libertaires, catholiques de gauche… et de nombreux casseurs cultivés, m’a soulevé le cœur, j’ai été encore bien plus dégoûté par la lâcheté de la classe politique et intellectuelle, par l’innombrable cohorte des opportunistes qui, le temps des affirmations et des négations souveraines venues, se dérobent toujours devant les responsabilités.
En septembre de la même année, j’ai décidé de quitter l’atmosphère étouffante et délétère de l’université. Je voulais m’éloigner, ne plus voir ces pseudo-révolutionnaires, ces enfants gâtés, privilégiés, narcissiques, tous ces tristes alliés objectifs du totalitarisme marxiste. J’étais encore beaucoup trop naïf et idéaliste et je ne plaisantais pas sur la défense de Charles de Gaulle, de la République, de la démocratie, de la patrie et de la nation. De Gaulle représentait pour moi la résistance contre l’Allemagne national-socialiste, la France libre… et en raison des expériences encore récentes de ma famille, qui avait été divisée entre résistants-gaullistes (membres des FFI) et pétainistes (dont un héros grand mutilé de la guerre de 1914, indéfectible partisan du vainqueur de Verdun), je valorisais particulièrement la confidence réconciliatrice faite par le général au colonel Rémy :, «Voyez-vous, Rémy, il faut que la France ait toujours deux cordes à son arc. En juin 1940, il lui fallait la corde Pétain, aussi bien que la corde de Gaulle» 1.
En 1962, à la fin de la guerre d’Algérie, j’avais à peine quatorze ans et je n’ai pas pu voir, ni voulu voir la politique machiavélique et inhumaine que le général avait menée contre les Français d’Algérie et les Harkis, ni l’ampleur du drame qu’ils avaient vécu. De Gaulle était, et reste encore aujourd’hui à mes yeux, un géant parmi les nains. Il ne pouvait y avoir pour moi de légalité ni de légitimité républicaine et démocratique en dehors de sa personnalité tutélaire. Nous l’appelions affectueusement Le Grand Charles, ou Double mètre, à cause de sa taille imposante et sa femme était pour nous Tante Yvonne.
L’ardent et bouillonnant jeune homme que j’étais voulait contribuer à sa manière à la défense des institutions de la République et de son président. Mais, jeune citoyen, ordinaire et anonyme, où pouvais-je donc le faire sinon dans l’armée ? C’est ainsi qu’en septembre 1968, j’ai rejoint l’un des plus prestigieux régiments, le Sixième régiment de parachutistes d’infanterie de marine. Le 6e RPIMA formait la 11e Division avec le 1er RPIMA, régiment de la Légion étrangère, et deux autres régiments de parachutistes.
Les hommes du 6e RPIMA avaient été totalement décimés en 1956 lorsqu’ils avaient sauté dans la vallée de Diên Biên Phu, pendant la guerre d’Indochine, sous le commandement du colonel Marcel Bigeard. À l’époque de mon service militaire, c’était le seul régiment d’appelés qui pouvait intervenir dans les conflits en dehors du territoire national.
Cet épisode de ma vie remonte à bien des années, à un demi-siècle, mais je ne renie aucune expérience de ma jeunesse. Simple soldat, j’ai connu le vrai peuple de France, le monde des ouvriers et des petits salariés, le monde des paysans, des petits artisans et des petits commerçants. Je me suis vite rendu compte que leurs préoccupations étaient à des années-lumière de celles des étudiants protestataires de mai 68. Ils les ignoraient, les méprisaient ou les détestaient. Ils les considéraient comme des agitateurs, petits-bourgeois, égoïstes qui voulaient tout, tout de suite, sans avoir à gagner leur vie très tôt ; d’irresponsables fils à papa, prétendument contre la société, mais qui ne faisaient qu’en profiter au maximum.
Seize mois plus tard, une fois mon service militaire terminé, je suis retourné dans les amphithéâtres universitaires. Mai 68 n’était déjà plus qu’un lointain souvenir. La priorité de la plupart des étudiants était d’étudier et de réussir leurs examens. Mai 68 n’a commencé à alimenter les grands débats médiatiques que quinze ans plus tard, à partir de 1981 quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir avec toute une génération d’anciens gauchistes reconvertis en membres du parti socialiste.
De Gaulle, on le sait, a démissionné en 1969. C’est aujourd’hui une icône de l’histoire de France. Beaucoup le louent, ou du moins, évitent de critiquer sa figure. Le plus drôle c’est qu’à cette époque déjà lointaine de Gaulle avait un très grand nombre d’ennemis féroces : parmi eux se trouvaient, d’une part, la droite pétainiste (les modérés, réformistes ou conservateurs de Vichy et les révolutionnaires anti-pétainistes, vrais fascistes de Paris), et, d’autre part, les défenseurs de l’Algérie Française, mais il y avait aussi, et surtout, les légions de leaders libéraux, démocrates-chrétiens, socialistes, sociaux-démocrates, communistes et gauchistes. En 1968, dans les lycées et les universités, la jeunesse gaulliste constituait une petite minorité dépourvue d’influence. Les vrais activistes, violents et enragés, étaient les gauchistes (environ 15 000 à Paris). Ils étaient une sorte de branche armée, de l’université marxisée.
En raison de leur activisme élitiste, frénétique et belliqueux, mais aussi de la peur et de la subjugation de l’immense majorité des étudiants, ils occupaient une position dominante, voire hégémonique du moins dans les facultés littéraires et de sciences sociales. Devant eux se dressaient les quelques activistes, tout aussi violents, du mouvement Occident, un mouvement radical de droite (en fait une poignée de jeunes anticommunistes passionnés, opposés à la fois à la gauche marxiste et aux gaullistes). Leur nombre ne dépassait guère les 1500 membres à Paris et peut être les 2500 en France. Deux décennies plus tard, trois de leurs dirigeants ont été des ministres libéraux de Mitterrand, Chirac et Sarkozy : Gérard Longuet, Alain Madelin et Patrick Devedjian.
Cela dit, il faut souligner que dans la France de 1968, il y avait un demi-million d’étudiants, et que les militants de l’ultragauche constituaient une minorité d’à peine 20 000 à 30 000 personnes dans tout le pays.
Entre 1958 et 1969, de Gaulle incarnait avec un certain succès le national-populisme français, c’est-à-dire la troisième voie, l’ordo-libéralisme, la synthèse entre droite et gauche, l’indépendance et la souveraineté nationales, le rejet du collectivisme marxiste et du capitalisme sauvage, la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, l’opposition au néocolonialisme américain et l’alliance avec le Tiers Monde. Il avait retiré la France de l’organisation militaire intégrée de l’OTAN, stigmatisé l’intervention américaine au Vietnam dans son célèbre discours de Phnom Penh, et condamné la politique d’Israël après la guerre des Six Jours. Au fond, il avait fait tout ce que les conservateurs, les néolibéraux, les socialistes et les progressistes détestaient.
De Gaulle est sorti de la crise, fin juin 1968 renforcé par les votes des électeurs, mais il est tombé un an plus tard, vaincu par l’ensemble de l’oligarchie politique, par la coalition des néolibéraux et des progressistes de gauche. Par la suite, pendant quarante ans, la plupart des gaullistes autoproclamés, tels Chirac, Sarkozy et de nombreux ministres, se sont massivement convertis au néolibéralisme. Certains ont continué à se proclamer gaullistes, louant la figure mythique du général, mais en fait, ils ont enterré soigneusement sa pensée et son héritage. Pour ma part, à partir de 1972, je ne me suis plus intéressé qu’à la philosophie politique et à l’histoire des idées et des faits.
Je termine ici cette longue parenthèse personnelle que je me suis imposée par devoir d’honnêteté et de transparence. Cela dit, deux aspects de mai 68 me semblent mériter de retenir notre attention : d’abord les faits historiques, ensuite les interprétations. Il faut bien sûr se demander d’abord quel a été l’impact réel des idées de mai 68 sur l’ensemble de la société française. Deux positions me paraissent ici absurdes : premièrement, celle des apologistes ou gardiens du culte de 1968 (dont les innombrables articles et dizaines de livres publiés à l’occasion du 50e anniversaire sont généralement superficiels et ennuyeux); deuxièmement, celle des censeurs, des auteurs de diatribes, qui ne veulent voir dans ces événements que la source et la cause de tous les maux de la société française, ou pire encore, l’origine de la crise des valeurs occidentales.
La profonde transformation du début des années 1960
En réalité, le mai 68 de Paris n’a été rien de plus qu’un grand carnaval, un psychodrame, une farce, une fièvre soudaine et éphémère, un mouvement ludique et libidinal, un délire nihiliste et irrationnel, une fausse révolution ou, comme l’a dit le philosophe et sociologue Raymond Aron, une révolution introuvable. Plus de 2000 personnes ont été blessées plus ou moins grièvement au cours des affrontements entre les deux camps, c’est-à-dire entre les manifestants et la police. Mais il n’y a pas eu de morts à Paris dans tout le mois de mai et une révolution sans morts n’est pas une révolution. En fait, il n’y a eu qu’un seul décès en mai, à Lyon et il s’agissait d’un commissaire de police qui a été écrasé par un camion lancé dans sa direction.
En juin, il y a eu également trois autres décès, mais lors de grèves dans des entreprises de Sochaux (Doubs) et de Flins. Les étudiants, rejetons de la bourgeoisie et de gens aisés, n’avaient pas du tout la détermination des vrais révolutionnaires, la volonté d’offrir leur vie pour leur cause. Ils ont bien sûr construit des barricades, brûlé des voitures, abattu des arbres, utilisé des barres de fer, jeté des pierres et parfois même des cocktails-Molotov sur la police ; ils ont aussi agressé des professeurs et des responsables universitaires lorsque ces derniers voulaient assumer leur rôle d’enseignants et osaient leur faire front.
Il y a eu des cas lamentables de violence physique contre des professeurs (dont le symbolisme n’avait rien à voir avec l’humour de potache), comme, par exemple, la poubelle d’ordures déversée sur la tête du doyen de l’Université de Nanterre, Paul Ricoeur, ou les œufs pourris cassés sur la tête de l’historien Pierre Chaunu. Mais rien de plus. Les forces de l’ordre n’avaient pas, quant à elles, le droit d’utiliser leurs armes. Elles ne devaient surtout pas tuer ces enfants de familles bourgeoises. Et le Premier ministre Georges Pompidou a tout fait pour empêcher l’effusion de sang.
Cela dit, il faut rester lucide. L’évolution et le changement des valeurs de la société française ont commencé non pas en 1968, mais à la fin des années cinquante et surtout au tout début des années 1960. Il se serait produit avec ou sans les événements de 1968, qui n’ont été qu’une sorte d’accélérateur. La décomposition de l’État-nation, l’attaque contre la famille, l’Église et l’École républicaine (avec la destruction de la méritocratie républicaine), le développement de l’hyperindividualisme, l’hédonisme et le consumérisme, l’américanisation, la permissivité des comportements, la tolérance sexuelle et le laxisme éducatif étaient en cours depuis des années au moins depuis la période 1962-1965.
Les années 1960 auront été en fait la décennie des changements intenses pour l’ensemble de la société française. Dans la période précédente, il y avait encore des points de référence fermes et structurants. Le culte des ancêtres était célébré ou respecté, il y avait de la modestie dans l’expression des sentiments, l’austérité dans la conduite était appréciée, l’étalage excessif de l’argent ou du succès financier était considéré comme une preuve de mauvais goût. L’école était encore celle des Hussards noirs de la République. L’enseignement public ou privé était de qualité ; l’éducation des enfants était stricte, les punitions sévères se faisaient ouvertement, devant tout le monde. L’élève dans les nuages ou médiocre se voyait au pire condamné à porter l’infamant bonnet d’âne. Les enseignants utilisaient la règle pour frapper les récalcitrants et les parents étaient presque toujours d’accord avec eux. Mais cependant, les enfants étaient heureux, ils jouaient dans les rues, dans les champs, dans les terrains vagues, ce qui serait aujourd’hui impossible. Il y avait une certaine discipline dans les corps, on ignorait le victimisme, et il n’y avait pas beaucoup d’enfants qui se plaignaient devant leurs copains. L’éducation, l’urbanité et la civilité l’emportaient sur la spontanéité et l’exhibitionnisme. Le pays devait être héroïque, noble et courageux. Le monde était moraliste, dur, mais pas inhumain comme aujourd’hui.
Quelques faits historiques importants permettent de comprendre comment s’est forgé l’esprit de la génération française de 68. En 1947, l’ère de la décolonisation commence (en Afrique et en Indochine); elle durera jusqu’en 1962, année de la fin de la guerre d’Algérie, marquée par l’exil de plus d’un million de pieds-noirs ou Français d’Algérie. Dans les années 1950 et 1960, l’économie française connaît ses taux de croissance les plus élevés (c’est la période souvent qualifiée de Trente glorieuses : 1945-1974). Le pays entre résolument dans l’ère de la société de consommation. La modernisation de l’ère gaulliste (1958-1969) s’inscrit dans le cadre d’un patriotisme historique, mais elle a pour effet indésirable l’apparition d’un nouvel hédonisme et d’un antipatriotisme radical dans la jeunesse. Choyés et mis souvent au pinacle par leurs parents, qui avaient subi les menaces et les rationnements de la Seconde Guerre mondiale, les adolescents et les jeunes de la bourgeoisie commencent à se rebeller contre la hiérarchie et l’ordre gaulliste. Cette jeunesse, nouvel acteur social, s’avérera incapable de faire la distinction entre pouvoir et autorité.
L’université, qui avait été jusque là réservée à une élite, devient une université de masse dans les années 1960. Il y avait 200 000 étudiants en 1958, 500 000 dix ans plus tard, en 1968. On en compte actuellement pas moins de 2,6 millions. En 1968, la génération du baby-boom, née entre 1945 et 1950, est déjà sortie de l’adolescence; ses membres ont entre 18 et 23 ans. Ils connaissent depuis sept ou huit ans le mouvement hippie venu d’Amérique du Nord; c’est le temps des festivals de musique, des communions de Paix et d’Amour nourries par les expériences avec le LSD, les drogues douces et dures. Pour la première fois, le problème de l’immigration en provenance de l’extérieur de l’Europe commence à se poser. Au lieu de moderniser l’outil de production, les patrons préfèrent utiliser la main-d’œuvre à bon marché d’Afrique du Nord et d’Afrique noire. C’est aussi l’époque de la construction du mur de Berlin (1961), de la loi autorisant la pilule contraceptive (loi du ministre gaulliste Lucien Neuwirth, adoptée en 1967), de l’intervention des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie (la fin du “Printemps de Prague” et du soi-disant socialisme à visage humain, en août 1968). C’est également l’époque du Concile Vatican II et de la métamorphose de l’Église catholique. Le temps des prêtres joueurs de guitare, comme la pauvre nonne sœur sourire, qui chantait, pauvre naïve, “Dominique, nique, nique” et qui finira pas se suicider.
Parmi les événements importants de l’époque, il ne faut pas oublier de citer la guerre du Vietnam et la mobilisation d’une grande partie de l’opinion publique internationale contre ce conflit, surtout après les bombardements aériens massifs du nord du Vietnam (en 1965). Il ne faut pas oublier non plus le conflit israélo-arabe, la guerre préventive des Six Jours (1967), qui a marqué le triomphe de l’État d’Israël sur ses ennemis arabes. La perception d’Israël est passée à ce moment-là du statut de victime à celui d’État sioniste agresseur. Et cela a été particulièrement vrai dans l’extrême gauche européenne dont une bonne partie se ressourcera trente ans plus tard dans l’islamogauchisme.
Deux indicateurs montrent bien l’éclatement de la société française à partir de 1975 : l’évolution des avortements et des divorces, suite à l’adoption, par le gouvernement libéral du président Giscard d’Estaing des lois autorisant l’interruption de grossesse et le divorce par consentement mutuel (en 1975).
En 1972, il y avait environ 410 000 mariages (pour une population de 53 millions d’habitants) ; en 2010, ce chiffre ne dépassait pas les 225 000 (pour une population de 67 millions). En 1972, le nombre de divorces était de 44 000 ; le chiffre actuel est d’environ 130 000 par an. Le nombre d’avortements est aujourd’hui d’environ 220 000 par an pour 730 000 naissances (un chiffre assez semblable à celui des immigrants qui entrent chaque année sur le territoire national, soit entre 210 000 et 220 000, depuis 2004).
Au tout début des années 1960, le catholicisme français a connu une certaine embellie, mais après le Concile Vatican II (1965), le déclin a été rapide et brutal. Entre 20 % et 25 % des Français allaient à la messe en 1960-1965, ils ne sont plus que 2 % aujourd’hui. 94 % pour cent des Français étaient baptisés en 1965 ; ils ne sont plus que 68 % aujourd’hui et à peine 30 % pour les enfants de moins de sept ans. En 1967, un épisode très significatif, aujourd’hui oublié, a démontré le mal-être, les atermoiements et les barguignages de l’Église française : le bras de fer entre les autorités administratives de l’Institut catholique de Paris (seule faculté privée de l’époque) et leurs 30 000 étudiants.
En octobre, le recteur, Mgr. Hauptmann, appuyé par la majorité des évêques, a décidé de supprimer les branches sciences humaines de l’Institut. Il considérait sans objet et inutile de concurrencer les facultés des universités publiques dans les matières «profanes». Il avait probablement l’espoir de faire taire les accusations répétées de porter atteinte au monopole d’État dans l’éducation supérieure. Ce mouvement de résistance et de grève des étudiants de l’Institut catholique a duré près de sept mois, d’octobre 1967 à mai 1968. Ignoré des médias parce que catalogué ou tenu pour déphasé, il a débouché sur un échec total.
En revanche, les années 1960 ont été les années heureuses du marxisme : trotskisme, maoïsme, castrisme, guévarisme et situationnisme (les marxistes de l’école de Georg Lukács et Rosa Luxemburg, tel Guy Debord). La plupart des grandes figures intellectuelles françaises étaient alors fascinées par le mythe de la révolution. Ce mythe avait été installé dans l’inconscient des Français, par l’éducation publique, génération après génération. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait donc beaucoup d’intellectuels qui voyaient dans les révolutionnaires marxistes, Lénine, Staline, Trotski, Mao, Castro ou Guevara, les plus parfaits continuateurs des révolutionnaires de 1789 ou de 1793. Durant des décennies et des décennies, imperturbablement, les livres scolaires français ont présenté la révolution bolchevik sous les couleurs idéales du romantisme révolutionnaire. L’Université était, on ne le répétera jamais assez, largement marxisée.
De nombreux intellectuels, journalistes et universitaires, critiquaient sévèrement le PCF et le marxisme soviétique, mais ils le faisaient au nom de l’idéal trotskiste ou maoïste. L’influence du PCF et de son syndicat, la CGT, était pourtant encore considérable. En 1947, le PCF recueillait 25 % des voix dans les consultations électorales, mais il en avait encore 20 % dans les années 1970. Le Parti socialiste allait devoir attendre les années 1980 pour pouvoir enfin dépasser électoralement le PCF.
Bien évidemment, en raison de la déstalinisation soviétique (1956), l’image impeccable du modèle soviétique était déjà passablement altérée. Les modèles chinois, vietnamiens, cambodgiens et cubains étaient donc naturellement plus en vogue dans “intelligentzia“. Le nombre des victimes du marxisme n’avait d’ailleurs guère d’importance (et pourtant on savait l’ampleur du massacre même si le chiffre de 100 millions de morts n’était pas encore connu). Les idées marxistes étaient déclarées justes et bonnes. L’important était de construire grâce à elles un monde meilleur. Le seul problème était les traîtres qui adultéraient l’idéal et qu’on était donc moralement en droit d’éliminer. De toute façon, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. La fin justifie les moyens. La terreur était considérée comme regrettable (du moins dans le discours public), mais nécessaire (dans la conversation privée).
Une grande partie de la gauche française admirait sans réserve la révolution culturelle des Gardes rouges (1966). Pour les journalistes, maoïstes et prochinois, militants ou sympathisants, la Chine de Mao était même le pays le plus libre du monde. Jean-Paul Sartre et le cinéaste François Truffaut vendaient dans la rue le journal maoïste La cause du peuple. Le cinéaste Jean-Luc Godard projetait à Paris, en septembre 1967, son film passablement ennuyeux, La Chinoise, et présentait les thèses obscures et intellectualistes des maoïstes de l’École Normale Supérieure de la rue Ulm. Mao mettait fin à deux années de révolution culturelle en déportant 17 millions de jeunes Gardes rouges, condamnés à travailler dans les champs, mais en France, ce travail forcé était considéré comme ”une chance pour la Chine”, une expérience agréable et festive.
Il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. La Chine était donc un paradis, “la société de mes rêves“, comme répétaient inlassablement les perroquets de la révolution cubaine. Régis Debray avait été emprisonné en Bolivie et condamné à 30 ans de prison (en novembre 1967) pour avoir voulu se battre avec le Che (les controverses sur sa responsabilité dans la mort de l’Argentin ne viendraient que plus tard). Bref, le marxisme avait le vent en poupe, et ses leaders, orthodoxes ou hétérodoxes, avaient une dimension et une aura qui ferait aujourd’hui pâlir d’envie bien des admirateurs du nouveau paradis vénézuélien de Maduro, que sont les partisans de la France insoumise de l’ancien sénateur et ministre cathophobe Jean-Luc Mélenchon.


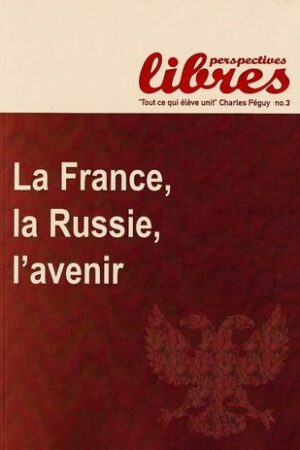



0 commentaires